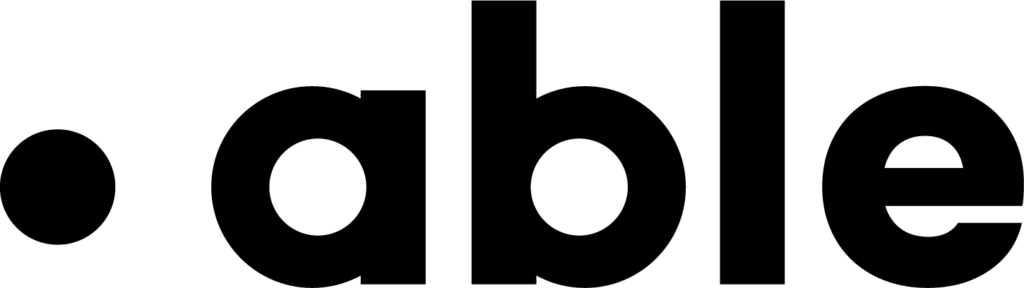
soumission d’une pré-contribution : instructions, recommandations et critères d’évaluation
La soumission d’une pré-contribution est la première étape du processus de publication sur .able. Cette soumission est examinée en interne, par notre équipe éditoriale, pour vérifier sa conformité avec notre positionnement éditorial et qu’elle répond bien aux attentes spécifiées dans notre formulaire de soumission et explicitées davantage ci-dessous.
Cet examen effectué, si la pré-contribution est retenue, nous reviendrons vers vous pour vous aider à aboutir une proposition de contribution prête à être soumise à l’évaluation par les pairs (cf. description du processus éditorial).
Compte tenu des nombreuses propositions de pré-contributions que nous recevons et afin d’optimiser votre temps comme le nôtre, il est très vivement recommandé de lire et de prendre en compte les recommandations qui suivent. La connaissance de ces critères doit vous permettre de mieux les anticiper et donc de bien préparer votre avant-projet (pré-contribution) puis votre projet (contribution). Cela permettra d’avancer plus rapidement vers une proposition évaluable par nos reviewers et d’éviter ainsi que nous vous demandions des compléments et modifications.
Pour rappel, le formulaire de soumission d’une pré-contribution est accessible en ligne via ce lien
1- pourquoi ces contraintes et donc ces recommandations ?
Si nous n’adoptions pas des formats bien définis, chaque projet nécessiterait un effort de développement spécifique, y compris pour lui permettre d’être adapté à toutes les situations d’usage et de plateformes. Au-delà, nous devrions également trouver des solutions toutes aussi spécifiques pour exporter ces projets vers les réseaux sociaux comme pour le format PDF. C’est beaucoup trop lourd. Le cas par cas mettrait en péril l’économie de notre revue. L’équipe doit rester mobilisée pour répondre aux demandes de plus en plus nombreuses de contributions afin de les publier dans les meilleures conditions possibles.
Ces formats, qui ont fait l’objet d’une conception affinée et de nombreuses expérimentations, doivent ainsi être compris comme des cadres de contraintes productives avec lesquels vous êtes invité.es à jouer.
2- pourquoi proposer un essai visuel pluridisciplinaire ?
.able est une revue qui publie des essais visuels dans le domaine de la création (en art et / ou en design) coopérant, en recherche, avec d’autres disciplines scientifiques (sciences de la nature, sciences humaines et sociales, sciences de l’ingénieur, sciences médicales, etc.).
Il est recommandé dans votre pré-contribution de :
• bien expliciter comment votre projet articule “recherche et création” et comment il le fait en impliquant des dimensions artistiques autant que scientifiques
• justifier en quoi l’usage d’un essai visuel est pertinent pour votre projet ; c’est-à-dire qu’est-ce que cette approche visuelle permet que le texte ne pourrait pas accomplir.
• par conséquent, expliquer le type de visuels et d’approche visuelle générale retenus (et cela dès la “présentation du projet” attendue dans le formulaire de soumission).
À noter : vous serez amenés à expliciter celle-ci de façon plus précise en suivant les recommandations ci-après, ces précisions pourront alors être apportées dans l’avant-dernière entrée du formulaire de soumission -“plus d’informations sur votre approche visuelle”.
3- comment choisir le bon format et argumenter ce choix ?
comprendre le caractère distribué de la plateforme :
.able est une revue qui publie des essais visuels multiplateformes selon 5 formats (scroll.able, pan.able, zoom.able, story.able et video.able). “Multiplateforme” indique ici aussi bien une variété de supports matériels (ordinateur, tablette, smartphone, grand écran, papier) qu’une diversité d’environnements de publication (web, réseaux sociaux – Instagram, Facebook, LinkedIn -, HAL, PDF). S’agissant des supports électroniques, nous utilisons un système de design “responsif” qui permet à la revue et donc aux essais publiés de s’adapter automatiquement aux différents supports. Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, nous avons mis en place des principes visuels et interactifs permettant de jouer au mieux avec les contraintes de ces applications.
Exemple : sur Instagram, en publiant un post sur le mode “carrousel” (série d’images qui s’enchaînent à l’horizontal), nous pouvons reproduire en partie nos pan.able en reconstituant une frise continue.
choisir et justifier son format :
Dès votre proposition de pré-contribution, il est attendu que vous ayez choisi l’un des cinq formats de publication. Pour cela, il est recommandé de bien étudier les formes singulières de ces formats autant que leurs différentes modalités de fonctionnement (telles qu’explicitées dans la partie “contribuer” de la plateforme web). Puisque ces formats s’adaptent à leur support, il est essentiel de bien les prendre en compte dans ces différentes situations.
Pour choisir votre format, explorez les modalités offertes par chacun des 5 formats disponibles sur la page « contribuer« , vous pouvez également consulter les articles déjà publiés sur la page « découvrir«
Exemples :
Le format scroll.able est, par nature, particulièrement bien adapté pour une consultation mobile. Il permet, à la façon d’une pellicule ou d’un papyrus, un déroulement vertical ascendant ou descendant. Sur desktop, il se dote de marges sur ses côtés.
Le format pan.able invite davantage à la contemplation avec son format horizontal. Sur mobile, il invite les utilisateur.ices à passer en mode paysage pour une expérience optimale.
Le format zoom.able offre une interaction riche et assez différente en fonction de l’appareil sur lequel il est utilisé, notamment en raison de son interaction spatiale que l’expérience tactile vient enrichir.
Le format story.able apparaît comme une planche de bande dessinée (une matrice de cases) sur les écrans horizontaux des ordinateurs, alors qu’il apparaît comme une pellicule (une bande d’images verticale) sur les écrans de smartphones en position portrait.
Le format video.able, en proposant différentes longueurs de films pour un même article permet de s’adresser à et de rencontrer des publics différents en fonction de la diffusion de l’article.
Il conviendra alors de justifier le choix du format, et cela en indiquant en particulier comment vous comptez utiliser et articuler ce format avec le(s) type(s) de visuel(s) retenu(s) tout comme avec le sujet et le sens de votre recherche.
Exemples :
Une pan.able peut aussi bien être utilisée pour représenter un paysage que comme le déroulement d’une ligne de temps. On peut y donner accès par son point le plus à gauche, mais aussi par le plus à droite, par son centre ou par n’importe quel point (cela étant aisément configurable).
La scroll.able peut aussi bien représenter une ascension qu’une descente, selon qu’on la fait démarrer par le bas ou par le haut, mais elle aussi peut démarrer de n’importe quel point.
La zoom.able peut être utilisée autant pour déployer un atlas que pour permettre des changements d’échelles à la façon d’un microscope. Dans tous les cas, ce n’est plus un format linéaire : elle invite à une navigation dans un espace, ce qui complexifie notablement sa conception (il est alors particulièrement recommandé d’éviter de travailler avec des fonds monochromes, noirs, blancs ou autres, qui perdent rapidement les lecteurs). Notez que vous pouvez envisager des zoom.able aussi grandes que vous le souhaitez, un serveur étant dédié à celles-ci.
Une story.able peut permettre la décomposition d’une action tout comme la présentation d’une base de données visuelles, et cela en prenant en compte la possibilité d’utiliser des légendes associées aux images, ce que les autres formats ne permettent pas.
Concernant, la vidéo, si le format peut sembler plus habituel, il est toutefois apprécié qu’il puisse lui aussi faire l’objet d’une approche expérimentale, réfléchie et argumentée, en notant par ailleurs que la vidéo est le seul format, sur .able, qui permet d’intégrer du son. Pour proposer des formes singulières en cohérence avec le sujet de recherche, il peut être utile de considérer des approches comme celles de l’anthropologie visuelle, des visual studies ou plus largement d’enquêtes audiovisuelles expérimentales, fictives ou non.
fonctionnement en couches et outil d’édition :
Pour les trois premiers formats (scroll.able, pan.able, zoom.able), il est proposé de mettre en œuvre une à trois couches visuelles, avec un paramétrage qui permet de les associer subtilement. Il est alors attendu que vous puissiez indiquer combien de couches visuelles vous souhaitez utiliser et comment vous envisagez de les associer suivant le format retenu.
Enfin, il est à noter que pour ces quatre premiers formats (scroll.able, pan.able, zoom.able, story.able), un outil d’édition en ligne, facile d’accès, est mis à disposition de chacune des équipes dont la contribution a été retenue, dès l’étape d’évaluation par les pairs passée. Au besoin, à partir de cette étape de travail, l’équipe de .able pourra vous accompagner lors de cette mise en œuvre.
4- en quoi votre proposition revêt-elle un caractère esthétique autant que réflexif ?
Certes, sur .able, nous publions des essais visuels, mais nous essayons aussi de publier de “beaux” essais visuels. En effet, nous sommes persuadés que la qualité esthétique de ces publications, en cohérence avec leurs propos, sont facteurs d’engagement et de connaissance.
Pour autant, ces contributions ne sauraient être de simples supports promotionnels pour les projets qu’elles présentent ; ce sont des essais stimulant la réflexion. C’est ainsi qu’au même titre qu’il est pertinent d’associer les arts et / ou le design avec les sciences, il nous semble nécessaire de conjuguer, indissociablement, des dimensions esthétiques et réflexives au sein de ces contributions. Il est ainsi attendu que les essais visuels publiés soient engageants tout en nous questionnant.
5- pourquoi impliquer un.e designer graphique peut s’avérer une excellente idée ?
Si les artistes impliqués dans les projets de contribution peuvent être des porteurs pertinents quant à la conjugaison d’approches réflexives et formelles, ils ne sont pas toujours les plus aguerris aux travaux graphiques mettant en jeu, par exemple, de la typographie, des systèmes de visualisation schématique ou cartographique, ou de l’interaction. Il est alors fortement recommandé d’envisager l’implication d’un.e designer graphique et d’interaction pour la conception et réalisation de l’essai visuel. Le ou la designer sera alors mentionné.e comme il se doit dans les crédits de la contribution en question.
6- pourquoi adopter un style de texte de présentation le plus limpide et compréhensible possible par un public non-expert ?
Nos essais visuels doivent à la fois répondre aux exigences académiques de la recherche ainsi qu’à celles du monde professionnel de l’art et / ou du design. Certes, mais ils doivent aussi être en mesure de toucher un public non-expert. C’est un des enjeux d’.able que d’être capable de s’adresser à ces divers publics.
Pour cela, et parce que nous estimons déjà être assez originaux voire “disruptifs” avec nos essais visuels, nous sommes attentifs à ce que les courts textes qui accompagnent ces essais soient les plus accessibles possible. Cette lisibilité est d’autant plus importante que ces textes sont le plus souvent affichés dans un second temps, après un nécessaire passage par l’expérience visuelle, et généralement dans un effort de compréhension après s’être confronté à la polysémie de l’image.
Aussi, est-il recommandé d’adopter un style d’écriture simple et explicite, avec un plan clair, caractéristique des approches de recherche, comme : contextualisation et positionnement, question de recherche, méthode(s) et description des expérimentations, résultat(s), débat, ouverture vers de nouvelles étapes de recherche ou de nouvelles problématiques.
Par ailleurs, l’écriture inclusive est encouragée.
7- pourquoi un texte court accessible qu’après avoir traversé l’expérience visuelle ?
Le texte qui sera publié aux côtés de l’image est limité à 3 000 caractères dans sa version initiale et à 4 000 caractères au final, avec ces 1 000 caractères supplémentaires exclusivement réservés pour un complément en réponse à d’éventuelles remarques des reviewers. Ce calibrage est nécessaire pour conserver un bon équilibre faisant d’.able une plateforme de publications d’essais visuels reposant non pas sur la relation classique “texte / images” mais plutôt, ici, “images / texte”.
8- quels sont les critères d’évaluation ?
Afin de formaliser votre pré-contribution puis votre contribution en anticipant les critères d’évaluation de nos reviewers, voici les termes essentiels de la grille d’évaluation donnée comme support à tous nos reviewers :
• pertinence globale du projet de recherche
Le sujet de recherche est-il clair ? L’approche interdisciplinaire est-elle identifiée et pertinente ? Le projet de recherche est-il pertinent au regard des recherches existantes ? Le projet de recherche propose-t-il une réflexion sur des enjeux contemporains (sociaux, environnementaux, etc.)• composition générale de l’équipe projet et complémentarité interdisciplinaire
L’équipe projet est-elle pertinente et équilibrée en termes de composition et d’interdisciplinarité ? Les moyens, parcours et compétences de l’équipe sont-ils en adéquation avec le sujet de recherche ?• intérêt de la proposition de publication basée sur l’image pour la revue .able
La proposition de projet basée sur l’image présente-t-elle un intérêt pour la revue compte tenu de sa ligne éditoriale ? L’approche visuelle est-elle explicite, originale et cohérente ? Permet-elle une compréhension renouvelée et/ou originale d’un sujet par le biais de l’image ?• pertinence du projet visuel et du format .able choisi
Le recours à l’image est-il justifié dans la proposition ? L’article visuel pourrait-il mettre en œuvre un processus réflexif à travers les images ? Les images occupent-elles une place centrale dans l’article ? Le texte justifie-t-il l’usage de l’image de manière pertinente ? Le choix du format (pan.able, scroll.able, etc.) est-il justifié et pertinent (de manière explicite ou implicite) ?• sens et réflexivité des images
Le contenu des images prévu pour l’article est-il cohérent et porteur de sens ? Le potentiel réflexif des images est-il suffisamment fort ? Les images sélectionnées sont-elles pertinentes par rapport au sujet de recherche de l’article ? Peuvent-elles, à elles seules, présenter le projet ? Peuvent-elles permettre une compréhension originale ou plus accessible du sujet traité et/ou d’un enjeu contemporain ?• qualité esthétique de la contribution visuelle
Les matériaux visuels choisis sont-ils intéressants pour .able ? Les images pourraient-elles être d’une qualité suffisante pour être publiées ? L’esthétique générale du projet est-elle intéressante, pertinente et/ou originale ?
9- remarques complémentaires diverses : langues originales, droits, production, etc.
concernant la langue de publication :
.able publie tous les essais visuels dans les trois langues de la revue : espagnol, français et anglais. L’une de ces trois langues doit être choisie comme langue originale de votre contribution. Vous pouvez donc soumettre votre article dans la langue de votre choix. Notre équipe pourra suivre l’ensemble du processus éditorial dans la langue ainsi choisie. Nous nous chargerons de la traduction de votre essai dans les deux autres langues. Chacun des essais dans chacune des langues disposera d’un DOI en propre, lui conférant une bonne autonomie, la langue originale de l’essai étant toutefois toujours affichée.
concernant les droits :
une fois un projet de contribution validé, après évaluation par les pairs, un contrat de cession de droits non-exclusifs vous sera proposé. Cela veut dire que vous conservez tous vos droits mais que vous nous autorisez à publier votre essai visuel et à communiquer dessus. Cela veut dire aussi que vous vous engagez à détenir l’ensemble des droits de ce que vous allez publier : nous vous invitons ainsi à bien vérifier ce point qui est souvent résolu soit par le fait que vous êtes producteur des images utilisées, soit par le fait que vous utilisez des images qui sont dans le domaine public ou dont vous détenez les droits d’utilisation.
concernant la production de votre contribution :
après l’étape d’évaluation par les pairs, dans le cas où la réponse est positive, vous devrez assurer la production de votre essai visuel par vos propres moyens, mais avec la possibilité d’utiliser les interfaces d’édition que nous mettrons alors à votre disposition et avec des conseils de notre équipe en cas de besoin de support technique.
10 – rappel des informations à fournir pour la soumission d’une pré-contribution
La liste ci-dessous reprend de façon synthétique les différents éléments attendus lors de la soumission d’une pré-contribution (cf. formulaire de soumission en ligne)
- titre (avec sous-titre, si nécessaire)
- auteur.ices / équipe du projet (avec les institutions affiliées ou le cadre, ainsi que l’ iD ORCID le cas échéant)
- un contact principal pour la contribution
- auteur.ices de la soumission (avec les institutions affiliées ou le cadre, le cas échéant, et si différents de ceux précédemment mentionnés)
- plusieurs images avec légendes et crédits (devant rendre compte de l’esthétique générale de votre contribution)
- un court texte présentant le projet et notamment sa problématique de recherche, sa méthodologie pluridisciplinaire et son approche/intention visuelle (maximum 3 000 caractères)
- description et argumentation de votre approche visuelle : pourquoi publier un essai visuel ? quels types de visuels seront utilisés (photos, illustrations, plans…) et pourquoi ? justifier le choix du format retenu et expliciter comment vous comptez le déployer (cf. recommandations ci-dessus)
- une liste de mots-clés (environ 10)
- pré-sélection d’un des cinq formats .able : scroll.able, pan.able, zoom.able, story.able, video.able
- bibliographie (au format Chicago 17e édition)
- informations et/ou références iconographiques ou toute autre information concernant les images ou le contenu média que vous avez l’intention d’utiliser (détenteurs des droits, contexte de production…)
- vous pouvez ajouter des ressources utiles, fichiers ou annexes